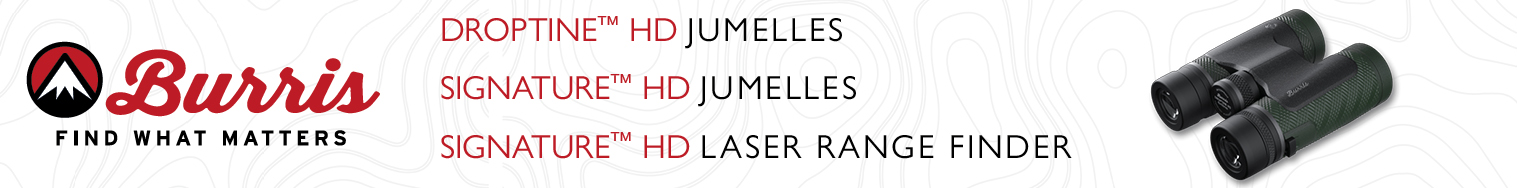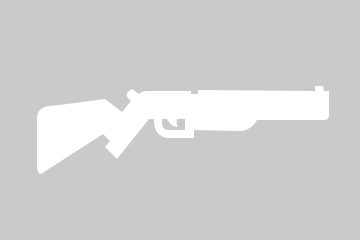QUAND LA CHASSE INSPIRE L’ART

La chasse a initié la première fresque connue… et elle constitue encore aujourd’hui une source d’inspiration majeure des peintres et des sculpteurs.
Texte de Francis Grange
Découverte en 2024 sur l’île de Sulawesi, en Indonésie, la plus ancienne peinture figurative identifiée à ce jour, datant de cinquante et un mille ans, représente un cochon sauvage entouré de trois silhouettes humaines, dont il s’avère très probable, au regard de la proximité des hommes avec l’animal, qu’il s’agit d’une scène de chasse. Ce que semble confirmer une autre fresque identifiée en 2017 sur la même île, estimée elle à quarante-quatre mille ans, composée d’un anoa (buffle nain) entouré d’hommes, avec deux traits illustrant des lances plantées dans sa poitrine. Les peintures rupestres apparaissent il y a environ trente mille ans en Europe, essentiellement en Scandinavie, en Italie, au Portugal et, pour les plus impressionnantes, en France et en Espagne. La chasse et l’art sont depuis intimement liés, ayant tous deux évolué en symbiose jusqu’aux fantastiques créations actuelles, particulièrement en matière de sculptures et de peintures.
Préhistoire : aurochs, bisons et chevaux
Jusqu’à l’aube de l’Antiquité, la quasi-totalité des fresques rupestres figurent des gibiers ou des scènes de chasse, souvent alors avec des animaux tués par des lances, des sagaies ou des flèches. Les gibiers de beaucoup les plus représentés sur les sites européens sont des aurochs, des bisons ou des chevaux, rarement des cerfs, des élans ou des bouquetins. Encore plus exceptionnellement des grands fauves, des mammouths, des rhinocéros laineux ou des ours, en outre presque jamais en situation de chasse bien qu’ils vivent en nombre dans les mêmes contrées. Les aurochs, les bisons et les chevaux s’affirment ainsi comme les gibiers les plus convoités du temps, ce que valident les amas d’os retrouvés près des lieux de leur consommation à l’intérieur des grottes, assurément parce qu’ils se montrent moins difficiles à chasser que les élans, les cerfs ou les bouquetins, plus méfiants et plus rusés, et infiniment moins dangereux que les grands fauves, les mammouths ou les rhinocéros laineux, autrement plus puissants et agressifs. Quant aux ours, les hommes d’alors leur vouent un véritable culte en raison de l’extrême courage nécessaire pour les affronter, par exemple pour s’approprier leurs cavernes et s’y installer, dévotion dont témoignent aujourd’hui les nombreux crânes et os d’ours découverts soigneusement rangés dans les cavités des grottes. La rareté des ours dans les représentations rupestres, bien qu’ils exercent sur les hommes un attrait quasiment mystique, confirme bien que ces fresques sont dédiées essentiellement, dans nos contrées du moins, aux gibiers et à leur chasse.
Antiquité : cerfs, lions et sangliers
Au tournant du Néolithique et de l’Antiquité, la chasse commence à perdre son statut d’activité purement nourricière pour se muer progressivement en loisir et surtout en moyen de s’affirmer au sein d’un groupe humain, en vue d’accéder à une position dominante ou de la légitimer. Pour le membre d’une tribu, vaincre un sanglier démontre son courage et contribue à attester sa capacité à en devenir le chef. Pour un monarque, combattre un sanglier ou un lion constitue une preuve de bravoure légitimant le statut supérieur que lui a conféré sa naissance. De même que poursuivre et abattre un cerf révèle un talent aiguisé en matière de ruse, de tactique. Ces exploits inspirent de nombreuses représentations artistiques sur des céramiques, des mosaïques, les murs intérieurs d’habitations ou des sarcophages, pour rendre alors hommage aux valeurs d’audace, d’ardeur et de vaillance de celui qui y git, sans toutefois aucun lyrisme et en restituant le plus exactement possible l’acte de chasse. La chasse n’est plus la seule source, ou quasiment la seule, d’inspiration des artistes. Elle partage désormais cette attribution avec l’amour, la religion et la guerre, en affichant néanmoins toujours son importance dans la vie du temps. Quant à la chasse de loisir, qui émerge à peine, elle se concentre essentiellement autour du lièvre et des oiseaux terrestres ou aquatiques, et n’est représentée que dans de rares œuvres grecques ou égyptiennes, laissant supposer qu’elle reste encore absente des autres parties du monde antique et donc de leur art.

Moyen Âge : cerfs, sangliers, lapins, lièvres…
La chasse gagne au Moyen Âge toutes les couches sociales et toutes les provinces de notre continent. Elle se positionne désormais en deuxième source d’inspiration de l’art, après la religion. Ces deux thèmes se rejoignent en outre à travers la légende de saint Hubert. Hubert de Liège naît vers 660 au sein d’une famille aristocratique. Il se passionne pour la chasse, mène une vie facile et se soucie peu de la religion. Un Vendredi-Saint, alors qu’il poursuit un cerf dans la forêt ardennaise, l’animal se retourne, un crucifix apparaît entre ses bois et une voix intime à Hubert de cesser de privilégier la chasse par rapport au salut de son âme. Il met pied à terre, se prosterne et demande ce qu’il doit faire. La voix lui répond de se rendre auprès de l’évêque de Maastricht, de se convertir et de faire pénitence de ses péchés. Hubert s’exécute, il voue désormais sa vie à Dieu et il devient lui-même plus tard évêque de Maastricht. Il meurt en 727, est canonisé en 743 et les chasseurs le choisissent alors comme saint patron. Sa légende inspire énormément d’artistes et elle élève le cerf au rang de gibier quasiment divin. Les seigneurs s’attribuent le privilège d’avoir seuls le droit de le chasser, en s’intéressant néanmoins aussi à d’autres gibiers tels les sangliers, les chevreuils, les perdrix, les faisans, les lièvres ou encore les lapins. Ces derniers sont toutefois essentiellement traqués par les paysans pour protéger leurs cultures des dégâts qu’ils leurs causent. Les scènes de chasse s’ouvrent à tous les gibiers et à une diversité croissante de modes de chasse. Le Livre de Chasse, élaboré de 1387 à 1389 par Gaston III de Foix, dit Gaston Phébus, un seigneur du sud de la France épris de chasse, en témoigne magistralement. Il flamboie d’illustrations d’une incroyable richesse artistique. Le Livre de Chasse entre dans l’histoire de la chasse et de l’art comme le plus fabuleux ouvrage cynégétique de tous les temps.

Miniature du Maître de Bedford XVe, extrait du Livre de Chasse
Epoque moderne : le cerf… et les autres gibiers
La Renaissance fait apparaître ou réapparaître de multiples sources d’inspiration pour l’art. L’amour, la mythologie, la guerre, la vie quotidienne, la fête… rejoignent la chasse et la religion. La chasse, bien qu’elle demeure un loisir privilégié de l’aristocratie, s’estompe aux yeux des artistes. Elle se concentre sur la vénerie et la fauconnerie, pratiques favorites des seigneurs du temps. Avec un animal toujours en exergue, le cerf, inscrit dans des scènes où les chiens sont, vénerie oblige, désormais eux aussi très représentés. La Renaissance, période faste pour l’art, a en revanche grandement réduit le rôle de la chasse comme source de son inspiration… Dès le XVIIe siècle, la chasse s’y réaffirme toutefois vigoureusement, avec un retour en place privilégiée, comme durant la Préhistoire, des gibiers, et désormais une présence majeure également des chiens. Le tout est souvent mis en scène avec une vive exaltation et une grande violence, peut-être liées au contexte des nombreux conflits sanglants qui secouent alors l’Europe. Les animaux les plus représentés sont, outre le cerf dont le prestige demeure à son apogée, le sanglier, l’ours, le loup… et même l’aurochs, bien qu’il ait totalement disparu du continent, mais dont le souvenir de l’extrême puissance continue à impressionner les artistes. Ce mouvement se poursuit durant tout le XVIIIe siècle, en s’enrichissant cependant de plus en plus de la présence de petits gibiers, dont la chasse se répand avec le développement des armes à feu portatives.

La légende de Saint-Hubert de Peter Paul Rubens.
Epoque contemporaine : la nature plus que tout !
Le XIXe siècle marque une mutation profonde de la chasse comme inspiratrice de l’art. L’homme y retrouve une place importante. La complicité du chasseur avec ses chiens, des chasseurs entre eux, la sérénité du gibier dans son environnement, sont de plus en plus mis en exergue. La mort s’efface devant la vie, la nature, les animaux qui la peuplent. La fin du siècle voit apparaître dans l’art des gibiers que le perfectionnement des armes rend beaucoup plus accessibles. Les chamois et les bouquetins séduisent nombre d’artistes. Le XXe siècle voit les chasseurs s’effacer de nouveau devant les chiens et le gibier. Les chiens constituent souvent le motif central, voire unique, des œuvres. Les animaux sont de plus en plus mis en lumière dans leur environnement. La chasse devient profondément écologique, respectueuse de la nature, de l’environnement, de la vie sauvage, de la diversité des milieux naturels et des animaux qui les peuplent. La prise de conscience croissante de l’importance cruciale de les préserver pour le devenir même de l’homme ramène, comme aux temps des toutes premières expressions artistiques, peintres et sculpteurs à s’imprégner ardemment de la chasse, réunissant ainsi les animaux sauvages et leur environnement naturel en un formidable duo inspirant magiquement l’art…