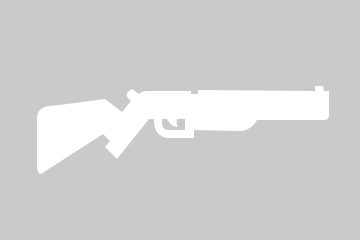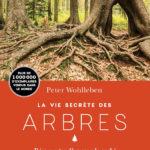
LE MUSCARDIN, UN RONGEUR QUI SE DÉCLINE EN DEUX ESPÈCES

Le muscardin, mignon petit rongeur arboricole, présente en réalité deux lignées génétiques extrêmement différentes, l’une à l’est et l’autre à l’ouest du pays. Elles sont par contre morphologiquement indifférenciables.
Texte de Manuel Ruedi, Wildtier Schweiz
Avec sa petite frimousse aux grands yeux noirs, sa longue queue touffue et son pelage brun doré, le muscardin fait certainement partie des petits mammifères les plus charismatiques de Suisse. Cette boule de poils pèse à peine une vingtaine de grammes et se nourrit avant tout de graines et de baies sauvages, avec une nette prédilection pour les noisettes, les faînes ou les glands. En dehors de la période automnale durant laquelle ces ressources abondent, il se nourrit également de bourgeons et d’autres végétaux. Il apprécie aussi les insectes, source indispensable de protéines animales.
Rongeur arboricole et nocturne
Ce mignon petit rongeur appartient à la famille des gliridés, il est donc apparenté aux loirs et aux lérots. Tout comme ces derniers, il est principalement arboricole et strictement nocturne. Il est difficile à observer dans la nature, mais il laisse parfois des indices typiques de sa présence lorsqu’il ouvre les noisettes avec ses petites dents bien aiguisées ou lorsqu’il construit son nid d’herbes sèches enchevêtrées et tapissé de mousses. C’est dans un tel nid construit à quelques mètres du sol dans des buissons (ou parfois dans un nichoir) qu’il passe la journée. La femelle élève habituellement entre trois et six petits par année, mais sa durée de vie n’excède pas quelques années. Lorsque vient l’hiver, le muscardin se retire dans un nid plus touffu, tapissé de mousse, qu’il construit cette fois au sol, entre les racines d’un arbre ou dans un trou. Il se roule en boule dans ce nid et va passer ainsi cinq à six mois d’hibernation en vivant au ralenti et uniquement sur ses réserves de graisses.
Comme il affectionne particulièrement les lisières et les haies, le muscardin fréquente toutes sortes de milieux forestiers, pourvu qu’ils soient bien structurés, avec une abondante strate buissonnante. Il est important que ces milieux soient bien connectés entre eux par des cordons boisés. Le muscardin vit surtout en plaine, mais se trouve aussi en régions de montagne jusqu’à une altitude de 2000 mètres, voire plus haut. Selon les données du dernier Atlas des mammifères sauvages de Suisse (Graf & Fischer, 2021), le muscardin est présent dans tout le pays, mais de façon clairsemée. La densité des populations est très diffcile à estimer car l’animal est tout de même très discret et exige des méthodes de recensement spécifiques pour être efficaces (tunnels à traces, pose de nichoirs adaptés). Ailleurs en Europe, le muscardin est distribué depuis la France jusqu’en Russie, et au sud depuis la pointe de l’Italie et de la Grèce jusqu’en Suède et en Angleterre méridionale. Il n’est jamais abondant et jouit d’une protection spéciale dans la plupart de ces pays.
Une ou plusieurs espèces de muscardins ?
Jusqu’à présent, les biologistes considéraient qu’il n’existait qu’une seule espèce de muscardin à travers toute l’Europe et le Proche-Orient, connue sous le nom scientifique de Muscardinus avellanarius (Linné, 1758). Morphologiquement, ces animaux varient en effet très peu d’un bout à l’autre de cette vaste répartition, avec tout de même quelques variants au pelage plus contrasté dans certaines région du centre de l’Italie, et leur biologie est également semblable pour toutes les populations étudiées jusque-là (von Witte, 1962).
En revanche, les premières données génétiques ont fourni tout de suite une autre image de la variabilité du muscadin en Europe. Une équipe de chercheurs dirigée par le professeur Johan Michaux et sa diplômante Alice Mouton a tout d’abord séquencé un gène mitochondrial et découvert que les populations ouest-européennes et celles plus à l’est étaient anormalement divergentes (Mouton et al., 2012). La distance génétique (une sorte de mesure du nombre de mutations qui séparent deux groupes) entre ces deux lignées majeures est de l’ordre de 11 %, soit environ cinq fois plus que ce qui est observé habituellement entre populations d’une même espèce de mammifères sauvages. Selon ces mêmes auteurs, une telle différence correspondrait à une séparation vieille d’au moins six à sept millions d’années, une durée là aussi considérable pour une seule et même espèce. Malheureusement, l’échantillonnage de ces chercheurs était trop grossier pour savoir si ces différences se retrouvaient à plus petite échelle. C’est là qu’une équipe suisse, composée de l’auteur de ces lignes comme chef de projet, sa diplômante Julie Manzinalli et son collègue du musée de Saint-Gall Lorenzo Vinciguerra, a pu démontrer que même à l’échelle de la Suisse, on retrouvait cette différenciation génétique énorme entre les muscardins de la lignée occidentale et ceux trouvés plus à l’est (Ruedi et al., 2023). Ainsi par exemple, les muscardins dans le canton de Vaud se différenciaient beaucoup de ceux du canton de Saint-Gall. Plusieurs gènes mitochondriaux ont été séquencés à cette occasion et tous indiquaient cette distinction marquée entre les deux lignées.
Pour définir si deux groupes de populations divergentes et géographiquement proches représentent ou non deux espèces biologiques distinctes, il faut savoir si elles se reproduisent entre elles. Autrement dit, il faut déterminer si elles échangent ou pas des gènes par reproduction croisée. Or, l’ADN mitochondrial n’est transmis que par les femelles, sans qu’il se mélange avec celui des mâles. Par conséquent, il est impossible de déceler l’existence de reproduction croisée sur la seule base de marqueurs génétiques mitochondriaux.
Des populations qui ne se mélangent pas
C’est encore l’équipe de Johan Michaux qui apporte la preuve ADN ultime en séquençant cette fois plusieurs gènes nucléaires, transmis autant par les mâles que par les femelles et se mélangeant à chaque génération. En réanalysant leurs échantillons de muscardins, cette fois avec des marqueurs génétiques nucléaires (Mouton et al., 2017), ces chercheurs ont confirmé que l’ensemble des populations européennes testées (soit plus de deux cents échantillons analysés) se subdivisent en au moins deux groupes principaux. Comme aucun individu intermédiaire (ou hybride) entre les deux grands groupes n’a été découvert, on peut admettre que ces populations ne se mélangent pas. Ils confirment aussi que ces groupes se divisent le long d’une ligne qui coupe grossièrement l’Europe en deux, exactement comme ce qui avait été observé avec les gènes mitochondriaux. Ces derniers auteurs ne sont pourtant pas encore convaincus par ces résultats probants et refusent de bouleverser la classification habituelle en gardant l’idée d’une seule espèce.
En reprenant ces résultats moléculaires et en considérant que de telles différences ne pouvaient se maintenir qu’en l’absence de flux de gènes, les chercheurs suisses ont alors démontré qu’il s’agissait bien de deux espèces biologiquement indépendantes (Ruedi et al., 2023). Cette nouvelle interprétation a d’ailleurs été corroborée par des analyses moléculaires encore plus récentes et plus complètes réalisées en Allemagne (Beez et al., 2024). Là encore, la présence de deux lignées clairement séparées a été prouvée et aucun individu intermédiaire ou hybride n’a été découvert. Même dans une forêt où les deux lignées sont en contact, elles ne se reproduisent pas entre elles (Leyhausen et al., 2022).

Hazel Dormouse
La 100e espèce de mammifère de Suisse
Grâce à ces apports génétiques multiples, une nouvelle espèce européenne de muscardin a donc été découverte, en plus de la forme « classique ». Comme ces deux formes ont également été détectées dans notre pays (Ruedi et al., 2023), une 100e espèce de mammifères sauvages de Suisse est donc venue s’ajouter aux 99 autres mises en évidence jusqu’ici (Graf & Fischer, 2021).
Comme il n’y a aucune différence morphologique externe qui pourrait distinguer ces deux espèces de muscardins (du moins d’après les connaissances actuelles) et qu’elles ne se différencient qu’au niveau génétique, on parle d’espèces cryptiques. De telles espèces existent dans tous les groupes animaux ou végétaux, notamment chez les pouillots, reconnaissables entre eux uniquement à leur chant.
Mais quel nom officiel donner à une espèce nouvelle, afin qu’elle soit aussi reconnue légalement ? Si véritablement aucun chercheur actuel ou historique n’avait publié de nom autre que le classique Muscardinus avellanarius, alors il aurait fallu en inventer un nouveau. Puis il aurait fallu faire une description basée sur un spécimen déposé dans un muséum et enfin publier ce nouveau nom dans une revue scientifique (c’est l’acte officiel qui scelle un nouveau nom d’espèce). Mais plusieurs noms de muscardins ont déjà été attribués au cours des deux derniers siècles. Par conséquent et après une minutieuse recherche de la littérature existante, les systématiciens sont arrivés à la conclusion que la lignée de l’est garderait le nom de M. avellanarius (ou Muscardin oriental pour son nom vernaculaire), alors que les animaux de la lignée de l’ouest s’appelleraient M. speciosus (ou Muscardin occidental), car c’est le nom le plus ancien attribué clairement à cette nouvelle espèce.
Tout reste à faire pour comprendre leur mode de vie et les protéger
De façon générale, ces deux espèces de muscardins fréquentent surtout les lisières de forêts bien structurées, peuplées de ronciers et de noisetiers qui leur fournissent gîte et couvert (voir photo). Même si génétiquement, il est indéniable que ces deux espèces sont très distinctes, les muscardins orientaux et occidentaux sont très semblables morphologiquement et il faudra des études plus approfondies pour éventuellement trouver des caractères externes qui permettraient de les différencier sur le terrain. Cette prochaine étape aiderait aussi à mieux connaître la répartition exacte de ces deux espèces. Pour l’instant, on sait que la lignée occidentale occupe toute l’Italie, la France, la Belgique, l’ouest de l’Allemagne, ainsi que l’ouest de la Suisse, tandis que l’espèce nominale se rencontre depuis la Scandinavie, le Royaume-Uni et les Balkans, jusqu’au Moyen-Orient. Outre le fait qu’elle traverse vraisemblablement le centre-est de la Suisse, la zone de contact de ces deux espèces n’est pas encore connue. Il s’agira également d’étudier leurs mœurs plus précisément, et mesurer quelles sont les interactions entre les deux espèces dans ces zones de contact.
Connaissances encore lacunaires
Avant cette découverte, le muscardin était considéré comme une espèce peu commune mais largement répandue en Europe. Elle est protégée en Suisse et dans plusieurs autres pays européens du fait de sa rareté. Puisque désormais le muscardin représente deux espèces distinctes, cela remet en question son statut global en matière de conservation, d’autant plus que chacune des deux subit vraisemblablement de fortes baisses d’effectifs suite à la disparition de leur milieu de vie. Si une population locale est menacée de disparition, il sera important de ne pas la renforcer avec des individus issus de la « mauvaise » lignée génétique, car ils ne pourraient probablement pas se reproduire avec l’espèce locale. Pire, comme ces deux espèces sont probablement très semblables à tous points de vue, elles seraient sûrement concurrentes et pourraient même s’éliminer mutuellement si elles étaient mises en contact artificiellement.
A l’heure de la conservation de la biodiversité, cette découverte démontre aussi que nos connaissances sur les espèces sauvages de nos régions sont encore bien lacunaires. Il est donc impératif de lutter contre l’érosion de la biodiversité qui menace nos écosystèmes et qui pourrait faire disparaître des éléments encore inconnus de notre faune.