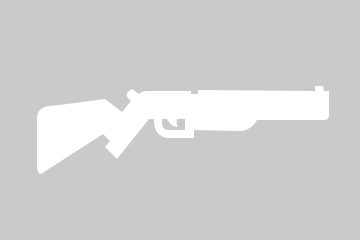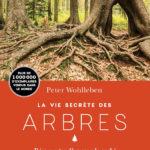
PETIT GIBIER EN SUISSE, PASSION D’IRREDUCTIBLES LATINS?

Le canton de Berne a une particularité, c’est un canton bilingue. Qu’en est-il de l’influence des zones linguistiques sur les pratiques de chasse ? Pour aborder une part de cette question, nous sommes partis d’un élément qu’on entend parfois dans les palabres cynégétiques : la chasse au petit gibier serait une spécificité latine.
Texte de José Gsell, photos de Mattias Meyer
Tout débute après une rencontre fortuite lors d’une partie de chasse. Martin Baumann, un germanophone (plutôt francophile avouons-le) était aussi étonné que nous de croiser d’autres chasseurs de bécasses. En effet, les spécialistes de la mordorée ne courent pas les rues dans le Jura bernois.
Plusieurs mois plus tard, je retrouve Martin dans sa maison du Seeland. J’y découvre l’ampleur du personnage.
L’homme et le chasseur
Cinq chiens s’approchent calmement et viennent nous saluer. Courants, terriers et chien d’arrêt. Chez lui, tout est conçu pour qu’ils circulent librement. En terrasse, la discussion s’entame en sirotant une limonade maison.
Martin dit avoir découvert la chasse comme une évidence, une suite naturelle à son attachement au monde animal. Pas de père chasseur signifie bien souvent beaucoup d’expérimentations. C’est par des chasses au cerf qu’il entame son apprentissage. Un jour, il lit un livre décrivant la chasse du sanglier aux chiens, en France. La passion des auxiliaires à poil le prend rapidement.
Trente-huit patentes lui ont permis d’accumuler une grande expérience, chassant ça et là, rarement très loin. Du sanglier au cerf, du chevreuil au chamois, du pigeon à la bécasse en passant par la pratique du renard au trou, Martin est polyvalent. Principalement en Suisse, parfois en France et en Allemagne, il dit ne pas être grand amoureux des voyages de chasse lointains, quelques expériences dans les pays de l’Est lui ont fait observer une éthique et des pratiques peu compatibles avec les siennes. Il constate là une absence de plaisir à l’idée de tirer un cerf à la vision thermique par exemple.
Biologiste de profession, il était chef remplaçant de la Section chasse et gestion de la faune sauvage à l’Office fédéral de l’environnement. Lors d’une discussion à propos de l’interdiction de la chasse à la bécasse avec des politiques et des chasseurs, il voit la mine décatie d’un groupe après la séance. Suivant quelques échanges avec ces bécassiers neuchâtelois, il se fait inviter à une chasse dans ce canton, lui qui pour l’instant ne sait absolument rien de la reine des bois et de sa quête.
L’expérience le marque, le travail de deux gordon setter lui insuffle le virus. Rapidement il se passionne pour cette chasse et lutte pour la sauvegarde de cette pratique et sa pérennisation.

Passion et profession engagée
Dès lors, il contribue à la mise en place de plusieurs stratégies de protection des bécasses indigènes tout en assurant la gestion durable des très grandes populations du Nord-Est européen. Il a tout d’abord harmonisé les réglementations cynégétiques cantonales romandes pour assurer qu’un minimum de bécasses indigènes soient prélevées par nos chasses automnales.
Il a ensuite développé un instrument d’aide financière aux cantons prenant des mesures pour sauvegarder et améliorer les habitats forestiers des bécasses nicheuses en Suisse (dans le cadre du programme RPT de la Confédération).
« bec@suisse »
Finalement, avec le soutien de l’ASB (Association suisse des bécassiers) et des cantons romands, il a entamé des travaux pour développer l’instrument nommé « bec@suisse » qui améliorera et facilitera le monitoring de cet oiseau et sa chasse en Suisse. En utilisant cette application sur leurs téléphones portables, les bécassiers pourront enregistrer facilement toutes les observations de bécasses et leurs signes de présence dans la nature. Ces données seront disponibles pour l’ASB et pour les cantons, permettant d’en savoir plus sur les populations de bécasse indigène hors saison de chasse, ainsi que leurs migrations automnales.
Avec une date mobile de l’ouverture de cette chasse dès l’arrivée du premier flux migratoire, on pourrait largement épargner les bécasses nicheuses tout en autorisant la quête des chiens sans tir jusqu’à l’arrivée des migratrices. L’ouverture des prélèvements suivrait l’afflux des bécasses en transhumance. Même si les travaux ont déjà avancé, cette application n’est pas encore fonctionnelle dans tous les détails. Martin est convaincu que les cantons finaliseront ces travaux comme prévu avec l’aide financière de la Confédération.
Désireux d’un changement, il a quitté son poste au sein de l’OFEV. Même si ces projets piétinent quelque peu, il reste persuadé qu’ils se concrétiseront tantôt et contribueront à la pérennisation de la mordorée et de sa chasse. À ce jour, il est consultant indépendant.
Et le petit gibier dans tout cela ?
Martin chasse la bécasse dans plusieurs cantons. Impossible de ne pas ressentir chez lui l’envie d’une pratique réfléchie et immersive, une chasse avec engagement dans le terrain, surtout avec des chiens et une grande connaissance de la faune. Il ne fait quasiment pas d’affût. La chasse pour Martin ne doit pas obligatoirement être productive en termes de quantité de nourriture. Le plaisir, l’émerveillement et le ressenti d’être à part entière un maillon de la biosphère lui importent autant que le contenu de son carnier, sa source quasi exclusive de viande pour la consommation domestique.
« Les spécialistes du petit gibier sont assez rares en Suisse allemande »
Martin nous témoigne qu’il existe bien des chasseurs prélevant du petit gibier chez les Bernois germanophones. Peut-être est-ce le canard qui tient le haut du panier, puis le renard, les corneilles et les cormorans, quelques pigeons parfois. Certains utilisent des chiens de rapport pour les canards mais pour la plupart, des tirs opportunistes sont plus courants qu’une spécialisation dans une pratique de chasse distincte. Partir pour une journée de chasse au renard, par exemple, a tendance à se perdre.
Hors canton de Berne, notamment à Uri, Glaris et aux Grisons, subsistent encore quelques spécialistes ayant des chiens créancés sur le lièvre et le lièvre variable, quelques autres chassant le lagopède et le petit coq, mais la tendance est de plus en plus à chasser ces gibiers sans chien.
Martin ajoute en passant que les Allemands étaient de grands chasseurs de petit gibier (perdrix grises, faisans, lièvres), mais qu’une diminution de ces pratiques est en cours car les terrains avec de bonnes populations de petit gibier sont devenues assez rares. Les raisons primordiales en sont l’agriculture intensive qui a détruit les habitats du petit gibier, ainsi que la prédation par des machines agricoles. Renards et corneilles s’occupent des survivants.
Les nombreuses races de chiens d’arrêt allemands dérivent de leur usage originel et sont utilisés pour chasser du poil et faire des recherches au sang, ainsi que pour rapporter des canards.
Un regard sur l’évolution des pratiques
Avec un petit pincement au cœur, Martin constate un changement. À travers l’usage des téléphones portables d’abord, qui s’est démocratisé à la chasse (on aura perdu les codes de communication avec les trompes), puis l’usage intensif des véhicules motorisés et finalement les outils de vision nocturne. Il dit « qu’on voit un cerf là où l’on ne pouvait pas le deviner auparavant, par exemple lorsqu’il est camouflé dans des aulnes ». On peut aussi observer des bécasses avec ces outils thermiques, mais est-ce encore de la chasse ou seulement du tir ? Cela nous pose clairement la question des conséquences d’une technocratisation de la chasse, clairement défavorable à nos chiens.
Nous concluons ensemble, avec sourire et dérision, que lorsque les battues se feront au drone et qu’il n’y aura plus la fanfare des courants, il sera temps pour nous de remiser nos fusils.